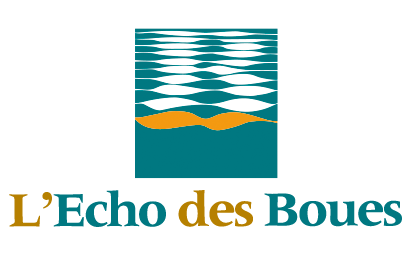Le recyclage agricole des produits résiduaires
Une pratique strictement règlementée et encadrée
Le recyclage agricole concerne différents produits résiduaires (PR) : boues d’épuration, urbaines ou industrielles, composts de boues, digestats de méthanisation, cendres de chaufferies biomasse, etc. C’est une filière bien organisée mais également très réglementée. Toutefois, si certaines règles s’appliquent à tous, d’autres sont plus spécifiques.
Quelle réglementation ?
La règlementation nationale correspondante, date, pour les textes les plus anciens, des années 97-98. Elle est actuellement en cours de révision. Elle comprend 2 textes principaux de référence : l’un pour les produits résiduaires d’origine urbaine et l’autre pour les industriels. Pour ces derniers, le texte de base est souvent complété par des arrêtés spécifiques. Ainsi, des arrêtés ministériels distincts régissent, par exemple, les installations papetières et les chaufferies biomasse. La gestion des PR, notamment leur épandage, n’y occupe souvent qu’un petit paragraphe. Et celui-ci renvoie généralement aux prescriptions du texte de référence.
A cette règlementation nationale s’ajoute, dans le Haut-Rhin, des règles locales. Elles sont issues d’un consensus à l’échelle départementale. Elles tiennent compte des contraintes et des spécificités du territoire : nappe phréatique, densité de population, types de sols, etc. Leur objectif est de sécuriser la filière pour les producteurs comme pour les agriculteurs.

Quels textes ?
La valorisation en agriculture des produits résiduaires est globalement calée sur la réglementation applicable aux boues d’épuration urbaines, à savoir :
- le décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées, codifié depuis aux articles R211-25 à 47 du Code de l’environnement ;
-
l’arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret précédent.
Pour les matières industrielles, l’arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, fait foi. S’y ajoutent les différents textes dits de branches. Par exemple, pour les cendres de chaufferies biomasse ou les boues de papeteries.
Enfin, des textes plus généraux s’appliquent à tous les PR. Par exemple, des prescriptions nationales et régionales sont prises en application de la Directive Nitrates. Elles régissent, entre autres, les épandages de tous les fertilisants azotés utilisés en agriculture : périodes d’épandage, doses, modalités de stockage…
Quelles règles ?
La règlementation nationale prône 2 principes fondamentaux : l’intérêt agronomique des matières épandues et leur innocuité pour l’homme et l’environnement.
Autre point important : le statut des produits résiduaires utilisés. S’ils sont considérés comme des déchets, au sens réglementaire du terme, ils sont alors soumis à plan d’épandage (sauf cas particulier des produits conformes à une norme). C’est la situation la plus courante.
Sinon, ils doivent respecter les prescriptions spécifiques :
- du règlement européen de 2019,
- d’un cahier des charges spécifique (digestats, par exemple),
- ou de leur autorisation de mise sur le marché, s’ils en ont une.

La réglementation établit les règles d’enregistrement des pratiques. Elle liste les documents réglementaires à produire :
- à l’élaboration initiale du plan d’épandage,
- puis, annuellement, au fur et à mesure des épandages.
Elle en définit également le contenu.
Les textes présentent les modalités de suivi des matières à épandre et des parcelles réceptrices. Ils fixent ainsi un nombre et une fréquence d’analyses à réaliser sur les parcelles et sur les PR. Ils déterminent aussi les teneurs à ne pas dépasser. Ils imposent, enfin, des prescriptions de stockage et d’emploi, selon les contraintes du terrain (captages d’eau potable, habitations, cours d’eau, etc.).
Les règles locales vont plus loin, avec, par exemple :
- le maintien de la traçabilité, quelle que soit la matière épandue, du lieu de production jusqu’au champ, même pour les produits normalisés ;
- l’envoi d’un courrier d’information en mairie pour les communes où des épandages sont programmés dans l’année ;
- l’interdiction des épandages en périmètres éloignés de protection de captages d’eau potable…